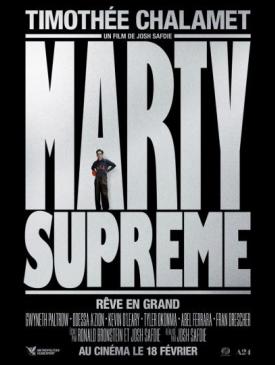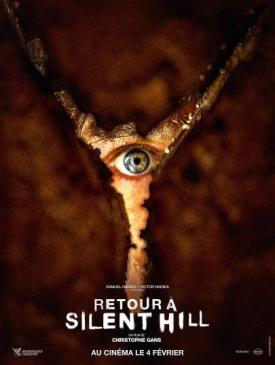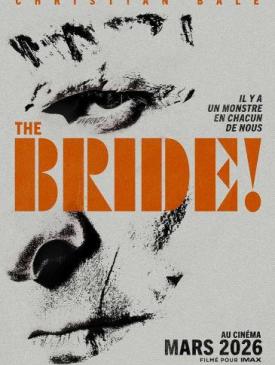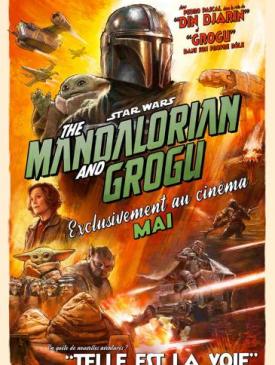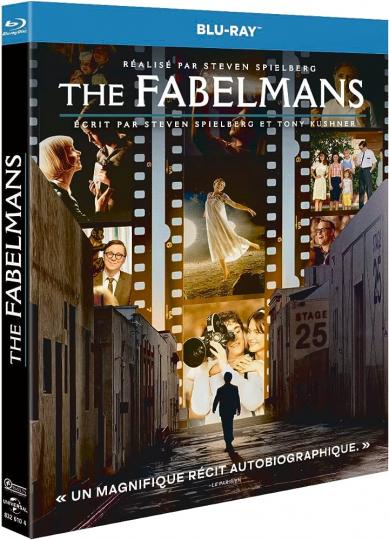
The Fabelmans
___
En Bref
Cette histoire commence dans une salle obscure du New-Jersey avec la projection du film Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B DeMille. Sammy, un petit garçon fasciné par le déraillement du train, tente de le reproduire à l'infini avec sa petite locomotive en jouet. Sur les conseils de sa mère, il finit par immortaliser la scène avec la caméra super-huit de son père. Dans la famille Fabelman, je demande la mère, musicienne, artiste qui se consacre désormais à sa famille. Le père, pionnier de l'informatique est un technicien reconnu. Pour lui, le cinéma n'est qu'un hobby, rien de bien sérieux. L'oncle Bennie, un ami de la famille, les accompagne partout. C'est un jeune adolescent qui se lance sous le soleil de l'Arizona dans la fabrication de films de bric et de broc. Cela devient bien plus qu'un hobby, une vraie passion, incluant les amis et ses sœurs dans des fictions. C'est la fracture sous le choc d'un secret que révèle la caméra. C'est un jeune garçon qui subit le harcèlement antisémite ordinaire des années lycée en Californie, pas loin d'Hollywood. Derrière cette histoire de famille se cache la naissance d'un grand réalisateur et une déclaration d'amour au cinéma.
Est-ce que le cinéma peut changer les choses ? Est-ce que les films nous transforment, nous aident à franchir les obstacles de la vie ? C'est une question récurrente que tout réalisateur se pose un jour ou l'autre. C'est bien le cinéma et le choc d'une séquence, catastrophe ferroviaire, qui éveille les sens d'un jeune garçon dans sa quête. C'est bien l'apprentissage dans le désert de Phoenix, premiers pas, premières histoires, qui confirment le désir. C'est le pouvoir de l'image et ce qu'elle dévoile dans le décor qui brise l'envol du phénix. Quand il a sa table de montage, il découvre un secret de famille. C'est encore le cinéma qui devient une arme contre la bêtise des années lycées quand Sammy, jeune adolescent, filme la journée d'intégration. Cette dernière est aussi la métaphore d'une œuvre qui cache bien plus de choses, sous les apparences d'un cinéma populaire générant souvent des blockbusters.
Le talent du réalisateur, comme d'autres avant lui, est de transformer une histoire anodine, voire banale, en une quête du graal. The Fabelmans nous raconte l'histoire en trois étapes d'un enfant, devenu adolescent et de sa passion pour le cinéma. Derrière cette trajectoire, nous retrouvons les thématiques d'une œuvre, les rapports chaotiques au père, la figure de la mère artiste, rebelle, le mythe et la féérie, le pouvoir de la magie de l'enfance, et bien d'autres encore. The Fabelmans nous rappelle combien les histoires simples sont souvent plus complexes qu’il n’y parait et nous livrent bien plus d'éléments sur notre rapport au monde. Il nous permet de relire non seulement les films marquants, de divertissement : ET, Rencontres du troisième Type, Duel, Les dents de la mer, Indiana Jones historiques : La couleur pourpre, L'Empire du soleil mésestimé, La Liste de Schindler, Lincoln, plus intimes : Le Terminal, The Fabelmans.
Tous ces films nous en disent beaucoup sur notre société, sur la famille, sur le pouvoir de nos rêves, la volonté de réussir sa quête, la vie. Derrière les apparences, un cinéma de divertissement, nous nous apercevons qu'il se cache bien plus de complexité. Il nous dit que le cinéma de Spielberg n'est peut-être pas si classique, dans sa forme, que le pensent certains. Le symbole, la féérie, le mythe, la famille nous renvoient à la quête du groupe et de l'individu, dans une mise en scène plus fouillée que le premier regard ne le laisse supposer. C'est un peu comme si nous regardions le doigt qui montre la lune, en oubliant l'essentiel. En cela, la dernière séquence, la confrontation avec un monstre du cinéma, John Ford, lui aussi cachant derrière ses westerns beaucoup de choses, nous en dit bien plus sur l'Amérique, le monde et nous-mêmes.
Le talent du réalisateur, comme d'autres avant lui, est de transformer une histoire anodine, voire banale, en une quête du graal. The Fabelmans nous raconte l'histoire en trois étapes d'un enfant, devenu adolescent et de sa passion pour le cinéma. Derrière cette trajectoire, nous retrouvons les thématiques d'une œuvre, les rapports chaotiques au père, la figure de la mère artiste, rebelle, le mythe et la féérie, le pouvoir de la magie de l'enfance, et bien d'autres encore. The Fabelmans nous rappelle combien les histoires simples sont souvent plus complexes qu’il n’y parait et nous livrent bien plus d'éléments sur notre rapport au monde. Il nous permet de relire non seulement les films marquants, de divertissement : ET, Rencontres du troisième Type, Duel, Les dents de la mer, Indiana Jones historiques : La couleur pourpre, L'Empire du soleil mésestimé, La Liste de Schindler, Lincoln, plus intimes : Le Terminal, The Fabelmans.
Tous ces films nous en disent beaucoup sur notre société, sur la famille, sur le pouvoir de nos rêves, la volonté de réussir sa quête, la vie. Derrière les apparences, un cinéma de divertissement, nous nous apercevons qu'il se cache bien plus de complexité. Il nous dit que le cinéma de Spielberg n'est peut-être pas si classique, dans sa forme, que le pensent certains. Le symbole, la féérie, le mythe, la famille nous renvoient à la quête du groupe et de l'individu, dans une mise en scène plus fouillée que le premier regard ne le laisse supposer. C'est un peu comme si nous regardions le doigt qui montre la lune, en oubliant l'essentiel. En cela, la dernière séquence, la confrontation avec un monstre du cinéma, John Ford, lui aussi cachant derrière ses westerns beaucoup de choses, nous en dit bien plus sur l'Amérique, le monde et nous-mêmes.
Patrick Van Langhenhoven
Support vidéo : 16:9 compatible 4/3 format d'origine respecté 1.85
Langues Audio : anglais-français - Dolby Digital 5.1
Sous-titres : français / anglais
Edition : Universal
Bonus
The Fabelmans un voyage intime
Une dynamique familiale
la création du monde The Fabelmans
• Titre original : The Fabelmans
• Titre québécois : Les Fabelman
• Réalisation : Steven Spielberg
• Scénario : Tony Kushner et Steven Spielberg
• Musique : John Williams3
• Direction artistique : Andrew Max Cahn
• Décors : Rick Carter
• Costumes : Mark Bridges
• Photographie : Janusz Kamiński
• Montage : Sarah Broshar
• Production : Tony Kushner, Kristie Macosko Krieger et Steven Spielberg
• Sociétés de production : Amblin Entertainment et Amblin Partners
• Société de distribution : Universal Pictures
• Pays de production : États-Unis
• Langue originale : anglais
• Format : couleur
• Genre : drame, récit initiatique
• Durée : 151 minutes
• Dates de sortie4 : 18 octobre 2022 (Festival Lumière) 22 février 2023
Distribution
• Gabriel LaBelle (VF : Jean-Stan Du Pac ; VQ : Charles Sirard-Blouin) : Samuel « Sammy » Fabelman
◦ Mateo Zoryon Francis-DeFord (VF : Aloïs Le Labourier Tiêu ; VQ : Noé Henri Rouillard) : Samuel enfant
• Michelle Williams (VF : Valérie Siclay ; VQ : Pascale Montreuil) : Mitzi Fabelman
• Paul Dano (VF : Donald Reignoux ; VQ : Sébastien Reding) : Burt Fabelman
• Seth Rogen (VF : Xavier Fagnon ; VQ : Tristan Harvey) : Benny Loewy
• Keeley Karsten (VF : Lana Ropion ; VQ : Marguerite d'Amour) : Natalie Fabelman
◦ Alina Brace (VF : Victoire Pauwels) : Natalie enfant
• Julia Butters (VF : Jaynelia Coadou ; VQ : Ludivine Reding) : Reggie Fabelman
◦ Birdie Borria (VF : Loïse Charpentier) : Reggie enfant
• Judd Hirsch (VF : Popeck ; VQ : Jean-Marie Moncelet) : l'oncle Boris
• Sophia Kopera (VF : Mila Pointet) : Lisa Fabelman
• Jeannie Berlin (VF : Annie Balestra) : Hadassah Fabelman
• Robin Bartlett (VF : Sylvie Genty) : Tina Schildkraut
• Sam Rechner (VF : Gauthier Battoue ; VQ : Xavier Dolan) : Logan Hall
• Oakes Fegley (VF : Hugo Brunswick ; VQ : Matis Ross) : Chad Thomas
• Chloe East (VF : Barbara Probst ; VQ : Lauriane S. Thibodeau) : Monica Sherwood
• Isabelle Kusman (VF : Jennifer Fauveau) : Claudia Denning
• Chandler Lovelle : Renée
• Gustavo Escobar : Sal
• Nicolas Cantu : Hark
• Cooper Dodson : Turkey
• Gabriel Bateman : Roger
• Stephen Smith : Angelo
• James Urbaniak : le principal
• Connor Trinneer : Phil Newhart
• Lane Factor : Dean
• Greg Grunberg : Bernie Fein
• Jan Hoag : Nona
• David Lynch5 (VF : Frédéric Cerdal) : John Ford
• Crystal : le singe
• Titre québécois : Les Fabelman
• Réalisation : Steven Spielberg
• Scénario : Tony Kushner et Steven Spielberg
• Musique : John Williams3
• Direction artistique : Andrew Max Cahn
• Décors : Rick Carter
• Costumes : Mark Bridges
• Photographie : Janusz Kamiński
• Montage : Sarah Broshar
• Production : Tony Kushner, Kristie Macosko Krieger et Steven Spielberg
• Sociétés de production : Amblin Entertainment et Amblin Partners
• Société de distribution : Universal Pictures
• Pays de production : États-Unis
• Langue originale : anglais
• Format : couleur
• Genre : drame, récit initiatique
• Durée : 151 minutes
• Dates de sortie4 : 18 octobre 2022 (Festival Lumière) 22 février 2023
Distribution
• Gabriel LaBelle (VF : Jean-Stan Du Pac ; VQ : Charles Sirard-Blouin) : Samuel « Sammy » Fabelman
◦ Mateo Zoryon Francis-DeFord (VF : Aloïs Le Labourier Tiêu ; VQ : Noé Henri Rouillard) : Samuel enfant
• Michelle Williams (VF : Valérie Siclay ; VQ : Pascale Montreuil) : Mitzi Fabelman
• Paul Dano (VF : Donald Reignoux ; VQ : Sébastien Reding) : Burt Fabelman
• Seth Rogen (VF : Xavier Fagnon ; VQ : Tristan Harvey) : Benny Loewy
• Keeley Karsten (VF : Lana Ropion ; VQ : Marguerite d'Amour) : Natalie Fabelman
◦ Alina Brace (VF : Victoire Pauwels) : Natalie enfant
• Julia Butters (VF : Jaynelia Coadou ; VQ : Ludivine Reding) : Reggie Fabelman
◦ Birdie Borria (VF : Loïse Charpentier) : Reggie enfant
• Judd Hirsch (VF : Popeck ; VQ : Jean-Marie Moncelet) : l'oncle Boris
• Sophia Kopera (VF : Mila Pointet) : Lisa Fabelman
• Jeannie Berlin (VF : Annie Balestra) : Hadassah Fabelman
• Robin Bartlett (VF : Sylvie Genty) : Tina Schildkraut
• Sam Rechner (VF : Gauthier Battoue ; VQ : Xavier Dolan) : Logan Hall
• Oakes Fegley (VF : Hugo Brunswick ; VQ : Matis Ross) : Chad Thomas
• Chloe East (VF : Barbara Probst ; VQ : Lauriane S. Thibodeau) : Monica Sherwood
• Isabelle Kusman (VF : Jennifer Fauveau) : Claudia Denning
• Chandler Lovelle : Renée
• Gustavo Escobar : Sal
• Nicolas Cantu : Hark
• Cooper Dodson : Turkey
• Gabriel Bateman : Roger
• Stephen Smith : Angelo
• James Urbaniak : le principal
• Connor Trinneer : Phil Newhart
• Lane Factor : Dean
• Greg Grunberg : Bernie Fein
• Jan Hoag : Nona
• David Lynch5 (VF : Frédéric Cerdal) : John Ford
• Crystal : le singe