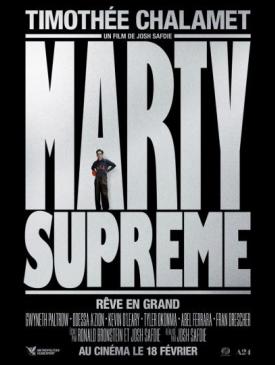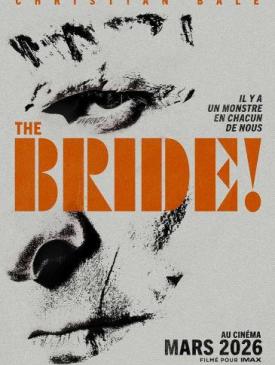Valentin Valentin
___
En Bref
Valentin s’installe dans un petit immeuble parisien pour une pause, le temps d’un soupir. Jeune garçon mélancolique, aisé, il se laisse porter par la vie en attendant de concrétiser son rêve. Régulièrement, sa maitresse, une belle brune envahissante, le rejoint pour un petit bonheur partagé. Les trois jeunes filles du cinquième, surtout une, aimeraient bien être l’élue de son cœur. Dans l’immeuble en face, il remarque une jeune Chinoise envoutante, parfum d’exotisme dans une existence sans faille.
Rajoutons dans son cercle un concierge pédophile, sa femme un peu trop démonstrative. C’est après une crémaillère festive que le vernis éclate et que sa petite vie paisible s’agite. Après Agatha Christie, c’est avec bonheur que Pascal Thomas adapte un roman de Ruth Rendell dans une comédie policière où le rire cache de lourds secrets. Depuis un certain temps, son cinéma gagne en onirisme. Il l’imprègne comme une touche légère, un parfum subtil, mais entêtant. Film le plus noir de l’auteur, il garde toute sa poésie en recomposant à sa manière le récit original. Cette « fenêtre sur cour » ressemble plus à une fenêtre sur l’âme qu’il examine avec tendresse. Cette comédie policière pleine de singularité enchante ce début d’année, à ne pas manquer.
Valentin Valentin représente ces petites vies qui s’agitent, s’étiolent, se frottent, se lâchent, osent l’impensable, se perdent dans la symphonie de l’existence où chacun joue sa note. L’immeuble devient le raccourci de notre existence, des rencontres, des histoires possibles qu’il faudra toute une existence pour tracer sur l’ardoise du temps. Il devient le temps des serments, des promesses, des choix, des routes à prendre pour les trois jeunes filles du cinquième. Elles se cherchent, entre l’art et la chanson qui ouvre chaque chapitre du grand livre de cette histoire, et l’amour qui va et vient. On s’attache, se détache, on aimerait bien plus qu’un regard dans l’escalier. Elodie essaye par tous les moyens d’attirer le regard de Valentin. Claudia, sa maitresse, s’accroche comme à une île lui évitant le naufrage de son couple.
Valentin n’a d’yeux que pour la petite Chinoise désespérée de la maison d’en face. Elle scrute le monde extérieur où elle voudrait s’enfuir, se perdre dans la nuit comme la dernière image du film. L’amour joue ses notes de joie, d’espoir, comme la vie, les couples se composent, marchent un bout de route ou s’évanouissent dans le brouillard. Marius et Rose finissent par se trouver, se toucher autrement que du regard. Valentin et ses histoires marquent le pivot central de cet immeuble, de l’existence. Le regard est un des points importants du film, celui des protagonistes les uns sur les autres, du spectateur, de l’immeuble sur ses habitants. Il se décline dans toutes les versions et positions. Le premier est celui du narrateur de la voix off en retrait, mais quémandant le droit de rentrer dans l’aventure. Sur cette trame narrative, la poésie s’infiltre, se dilue dans l’espace et les mots, les chansons, les regards, les gestes… Elle masque la noirceur profonde du récit, et plus particulièrement de la fin.
Celle-ci trouve sa face noire, moribonde et cruelle dans le portrait de Jane, vieille femme alcoolique rongée par le temps et les mots de l’existence. Géraldine Chaplin dans un ballet d’acteurs déjà exceptionnel, compose une figure triste et désespérée dans un jeu intérieur où le désespoir crie sa douleur. Dans la deuxième partie, le récit bascule, prend de la vitesse pour emporter ces petites existences au bout de leur agitation pour trouver leur place. C’est le moment de la séparation pour Valentin, de la vengeance pour le mari cocu. C’est le concierge pédophile admirablement interprété par François Morel, à la fois entre le vice et la petite voix qui dit non, mais se laisse déborder. Valentin entre dans le dernier mouvement du concerto de la vie, celui où nous prenons nos résolutions pour des vérités, claquons les portes et osons franchir le seuil.
L’histoire de la jeune Chinoise prend plus de place, phare dans le lointain, lumière pour guider les navires perdus dans la tempête. Du regard docile nous passons à l’action, chacun bouge, évolue, se lance dans la ronde, cesse de regarder par la fenêtre pour agir. Comme si la masse de toutes ses planètes dévoilait une galaxie en marche. Ils ne trouveront la liberté qu’en allant jusqu’au bout. La fin retrouve le livre de Ruth Rendell, jouant elle aussi souvent dans ses romans sur les apparences. Pascal Thomas ne garde que quelques éléments pour en refaire « une nouvelle peinture » comme il dit. La mise en scène donne de l’espace, s’amuse des lieux et situations pour composer une image où la lumière contrebalance une certaine noirceur du récit. Une fois de plus, le réalisateur nous piège sous le charme de ce nouvel opus à sa longue filmographie. Nous aimons la fraicheur et la poésie du récit, son onirisme et sa vérité captant cette parcelle d’humanité sans tricher.
Patrick Van Langhenhoven
Titre : Valentin Valentin
Réalisation : Pascal Thomas
Scénario : Clémence de Biéville, Pascal Bonitzer, François Caviglioli, Nathalie Lafaurie et Pascal Thomas, d'après Tigerlily's Orchids de Ruth Rendell
Montage : Yann Dedet
Photographie : Jean-Marc Fabre
Musique : Reinhardt Wagner
Producteur : Michel Merkt et Nathalie Lafaurie
Producteur délégué : Saïd Ben Saïd
Production : Les Films Français, SBS Production et France 2 Cinéma
Distribution : SBS Distribution
Pays d’origine : France
Genre : Comédie policière
Durée : 106 minutes
Dates de sortie :
France : 7 janvier 2015
Distribution
Marilou Berry : Élodie
Vincent Rottiers : Valentin
Marie Gillain : Claudia Livorno
Arielle Dombasle : la mère de Valentin
Geraldine Chaplin : Jane
Alexandra Stewart : Sylvia
François Morel : Roger
Christine Citti : Antonia
Louis-Do de Lencquesaing : Freddy Livorno
Félix Moati : Romain
Isabelle Candelier : Rose
Christian Morin : Marius
Victoria Lafaurie : Noor
Agathe Bonitzer : Florence
Karolina Conchet : Lys tigré
Christian Vadim : Sergio
Bernard Chapuis : le client de Rose
Valériane de Villeneuve : la femme au parapluie
Pascal Bonitzer : lui-même
Philippe Caroit : le patron de la SRPJ
Alain Kruger : le conducteur maladroit