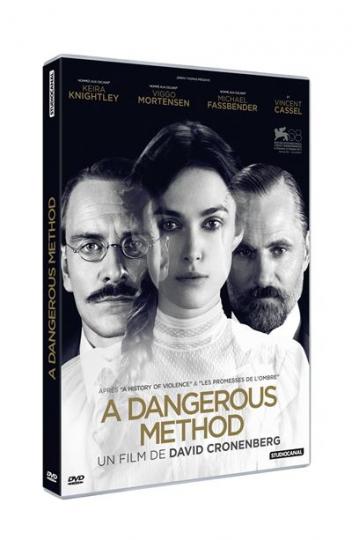
A Dangerous Méthod
___
En Bref
Qui connaît encore le nom de Sabina Spielrein ? Si la psychanalyse retient surtout le nom de Freud et de Jung, elle marque du sceau de l’oubli leur muse et consœur. Elle portera pourtant le message en Russie où elle donne naissance à tout un courant de la psychanalyse contemporaine. Le film s’ouvre sur un homme, Jung qui reçoit une nouvelle patiente atteinte d’hystérie. Peu à peu s’établit un dialogue à trois entre Freud, Jung et le cas de cette jeune femme qui les relie. Les huis clos s’ouvrent sur des séquences d’espace où la folie explose, devient animale. C’est aussi des lieux paisibles où le dialogue plonge sa force comme un couteau dans la chair, remise en cause, départ, voyage, retour, séparation. Le reste se déroule dans l’hôpital de Jung, le bureau de Freud, lieux sombres où l’éclairage en demi-teinte rappelle la lutte des ténèbres et de la lumière. Dernier espace, la chambre de Sabina, espace de transcendance ou sans doute s’élabore un troisième courant. Le film s’achève sur la séparation du trio, après s’être mutuellement influencés, avoir composé ensemble une première route, défriché un nouvel espace de l’esprit, où nous le verrons, le corps ne demeure pas absent. Vient le temps de la séparation, Freud creuse sa hantise, Jung mêle à sa recherche l’espace de la spiritualité du divin, et Sabina, reste un mystère.
A ma question avec vous un thème récurrent, il répond non. Pourtant, l’impact de l’esprit sur la chair, la chair en transformation, de Chromosome III à Videodrome, de La Mouche à Crash, marque la peau de ses personnages, en tout cas dans cette sphère diffuse qu’on appelle leur apparence. Il n’était pas étonnant qu’il se lance dans cette recherche de l’élaboration d’une méthode pour guérir notre esprit. D’ailleurs souvent celui-ci imprègne son questionnement, sa déroute dans notre chair. C’est du grand Cronenberg, l’image est soignée joue entre la demi-obscurité de l’homme tiraillé entre ombre et lumière et l’espace lumineux assez souvent proche de l’eau, lac ou océan.
Il faudrait peut-être y voir une autre symbolique de ce retour à l’espace aquatique de notre naissance, de l’origine du monde peut-être ? Il évite d’être trop bavard, de nous noyer dans un discours sans fin, au contraire chaque mot, chaque geste devient un élément important de la construction, du but final à atteindre. Nous assistons à la longue élaboration, de 1904 à l’aube de la Première Guerre mondiale, de la psychanalyse. Elle se déchaine devant nos yeux sans emportement, sans cri, mais dans la douleur , passions amoureuses, scientifiques, mentales de nos trois protagonistes, à la fois patients et médecins qui enfanteront les théories modernes.
Patrick Van Langhenhoven
Titre québécois : Une méthode dangereuse
Réalisation : David Cronenberg
Scénario : Christopher Hampton, d'après sa propre pièce, elle-même adaptée du roman A Most Dangerous Method de John Kerr (en)
Musique : Howard Shore
Montage : Ronald Sanders
Photographie : Peter Suschitzky
Décors : James McAteer
Costumes : Denise Cronenberg
Direction artistique : Anja Fromm, Nina Hirschberg, Kiko Francis Soeder et Sebastian Soukup
Production : Jeremy Thomas
Coproducteurs : Martin Katz, Marco Mehlitz et Karl Spoerri
Productrice associée : Tiana Alexandra-Silliphant
Producteurs délégués : Stephan Mallmann, Thomas Sterchi, Peter Watson et Matthias Zimmermann
Sociétés de production : RPC, Lago Film, Prospero Pictures, Astral Media, Canadian Film or Video Production Tax Credit, Corus Entertainment, Elbe Film, Millbrook Pictures, The Movie Network, Talking Cure Productions et Téléfilm Canada
Distribution : Entertainment One (Canada), Sony Pictures Classics (Etats-Unis), Mars Distribution (France), Lionsgate (Royaume-Uni)
Langues originales : anglais, allemand
Budget : 15 millions €
Genres : Drame biographique et historique
Durée : 93 minutes
Format : Couleur - 35 mm - 1.85:1 - Dolby Digital
Dates de sortie : 21 décembre 2011
dates sortie vidéo : 25 avril 2012 et 1 juin 2023
Distribution
Keira Knightley (VF : Sybille Tureau et VQ : Mélanie Laberge) : Sabina Spielrein
Michael Fassbender (VF : Stéphane Pouplard et VQ : Daniel Picard) : Carl Gustav Jung
Viggo Mortensen (VF : Gabriel Le Doze1 et VQ : Pierre Auger)2 : Sigmund Freud
Vincent Cassel (VF et VQ : lui-même) : Otto Gross
Sarah Gadon (VF : Chloé Berthier et VQ : Émilie Bibeau) : Emma Jung
André Hennicke (VQ : François Godin) : le professeur Eugen Bleuler
Katharina Palm : Martha Freud, la femme de Sigmund
Christian Serritiello : un officier
André Dietz : un officier de la police médicale
Andrea Magro : Jean-Martin Freud, le fils de Sigmund
Arndt Schwering Sohnrey : Sandor Ferenczi
Mignon Remé : la secrétaire de Jung
Mareike Carrière : l'infirmière chargée des repas
Franziska Arndt : l'infirmière chargée des bains











